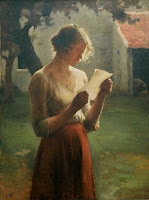|
| Aussurucq, cerca 1910 (Jacques Gorre) |
La commande est signée par le Maire, Dominique Eppherre, deux conseillers municipaux, Jean Etchart et Etienne Gette et l'entrepreneur, Pierre Inchauspé. Cette plaque est bien en vue aujourd'hui sous le porche de l'église du village. Elle nous rappelle que comme partout en France, Aussurucq - 472 habitants à l'époque - a perdu douze enfants pendant la Guerre de 1914-1918.
En perspective du centenaire de l'Armistice, j'avais publié une série de billets pour évoquer ces poilus tombés pour la France. Cette fois, à la faveur de délibérations municipales numérisées dénichées sur le site des archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, je me suis penchée sur les conseillers municipaux de l'après Grande Guerre. Comme partout en France, les élections municipales se déroulent à Aussurucq le 30 novembre 1919.
Les résultats indiquent que sur 158 électeurs inscrits, 128 ont voté, 123 se sont exprimés et une majorité absolue (62 suffrages) a élu les douze candidats inscrits. Un mois plus tard à la veille de Noël, le conseil municipal du 24 décembre 1919 élit Dominique Eppherre maire de la commune. C'est le frère aîné de mon grand-père paternel, Pierre.
Douze hommes tout juste élus conseillers municipaux de leur commune que je mets assez vite en parallèle avec les douze morts pour la France. D'ailleurs, si l'on regarde les deux listes, la répétition des noms interpelle. Je sais déjà que Michel Eppherre (1895-1916) est le frère cadet du nouveau maire. C'est également le cas de Martin Jaragoyhen dont le frère Bernard (1888-1916) tombé lui aussi à Verdun a été décoré de la Croix de Guerre.
Poussant un peu plus loin mes recherches sur les membres de ce nouveau conseil municipal, je fais une découverte à la lecture de leurs registres matricules également en ligne sur le site des AD64. La plupart d'entre eux ont été démobilisés dans le courant de l'année 1919 : Jean Achigar, Arnaud Basterreix et Pierre Jaury, en janvier ; Dominique Eppherre en février ; Pierre Barthe, Etienne Gette et Martin Jaragoyhen en mars ; Pierre Aguer en août.
Le plus âgé, Arnaud Etchart, avait été libéré définitivement en juillet 1917. Il faut dire qu'il avait déjà 47 ans ! Père de quatre enfants, son neveu homonyme et probable filleul figure aussi sur le Monument aux morts.
Ce qui frappe dans l'engagement de ces nouveaux édiles c'est leur sociologie. Tous cultivateurs, dans la force de l'âge et pour certains, déjà pères de plusieurs enfants. Le nouveau maire a 35 ans et est père de cinq enfants (il en aura onze !). Le plus jeune conseiller, Pierre Aguer, a 28 ans, le plus âgé, Jean Achigar*, 46 ans.
On note aussi que la génération précédente était déjà investie dans la vie publique. Le père du nouveau maire, Dominique Eppherre (1851-1928) - mon arrière-grand-père - a été conseiller municipal dès les années 1900 de même que Guillaume Etchart (1854-1935), frère aîné d'Arnaud. Etienne Gette est le fils de l'ancien maire, Jean Gette (1855-1936), démissionnaire en 1913 après plusieurs mandats.
Autre remarque mais qui n'est pas vraiment une surprise tant l'endogamie était forte dans ces villages de la Soule : à l'exception d'un seul, j'ai pu relier chacun d'entre eux à mon arbre généalogique ! Tous cousins en somme.
Enfin par curiosité, je me suis intéressée au Conseil municipal actuel, élu en mai 2020. Composé de onze membres dont trois femmes, il a pour maire un agriculteur en retraite de ma génération qui a choisi de s'entourer d'une équipe jeune. Parmi laquelle un certain Ximun Eppherre, jeune agriculteur de 26 ans et ... arrière-petit-fils du Dominique Eppherre de 1919.
*Concernant Pierre Campané, j'hésite entre deux frères (même prénom !) dont l'un avait 38 ans et l'autre 52 ans en 1919.