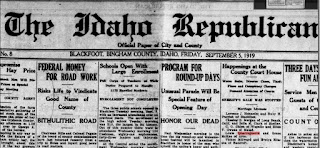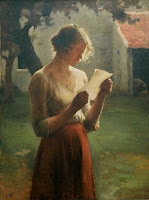En parcourant l'acte de mariage de mes trisaïeuls Martin Etchemendy et Isabelle Esponda avant ma "
rencontre" avec cette dernière, j'ai vu que celle-ci était fille unique. Néanmoins, il y était fait état d'un cousin germain du côté paternel auxquels ses parents avaient emprunté une assez grosse somme. Dette que le mariage avec "Martin l'
amerikanoak" allait pouvoir éponger...
Le cousin en question, Jean Esponda, cultivateur et maître de la maison Bordato à Béhorléguy, tel qu'il est mentionné dans l'acte en question, est né le 23 juillet 1821 et a donc trente ans quand il se marie le 24 novembre 1851 avec une jeune fille du même village, Dominica Larralde. Ensemble, ils auront d'abord deux fils dont le deuxième, Arnaud, décède à l'âge de cinq mois, suivis de huit filles. Cette famille, à première vue banale dans le contexte de l'époque, va pourtant me révéler bien des surprises.
Le 17 décembre 1873, Jean le père qui a plutôt bien réussi dans la vie au point de pouvoir aider son oncle dans le besoin, meurt à l'âge de 52 ans dans sa maison de Bordato. Huit jours auparavant, le notaire, Maître Jean-Baptiste Etcheverry de Saint-Jean-Pied-de-Port vient sur place rencontrer un homme malade certes mais "sain de corps et d'esprit" qui souhaite dicter son testament. Sa femme, Dominica Larralde en profite pour en faire de même.
S'ils sont assez classiques (jouissance des biens et usufruit au dernier vivant) et désignation d'une héritière, en l'occurrence la fille aînée Gracianne, née le 6 mai 1852, une mention dans ces testaments m'intrigue. Ils stipulent en effet que l'héritière doit rester dans la ferme et renoncera à ses droits si elle part en Amérique. Pourquoi cette précision ? Et surtout pourquoi aucune mention n'est faite du fils aîné, Jean, né le 2 janvier 1847 ?
L'explication viendra plus tard dans l'inventaire des biens familiaux demandé par Gracianne Esponda le 21 janvier 1875, le jour de la signature de son contrat de mariage avec Jacques Harguindeguy lui aussi natif de Béhorléguy. Pour la première fois, on évoque un frère Jean "consanguin", cultivateur à Buenos-Ayres !
Dans les registres de l'agent
Guillaume Apheça, déjà évoqués, je trouve bien un Jean Esponda de Béhorléguy embarqué le 5 décembre 1873 à bord de la "Gironde". Ce qui, si c'est bien lui, voudrait dire qu'il est parti deux semaines avant la mort de son père, lequel était déjà malade. Il est alors âgé de 26 ans et en toute logique devrait être l'héritier. Mais au Pays Basque, il n'était pas rare que les parents désignent un autre enfant pour leur succéder...
Envie de nouveaux horizons, "enrôlement" par un habile "marchand de palombes", reniement par ses parents qui lui préfèrent sa soeur et ne le mentionnent même pas dans leur testament ? Quelles sont les motivations de Jean ? Nous ne le saurons jamais... Mais une autre surprise de taille nous attend à la lecture de l'inventaire et du contrat de mariage de la fille aînée !
L'année 1874, c'est-à-dire celle qui suit le départ du fils aîné pour l'Argentine et la mort du père, voit mourir trois sœurs dans la maison Bordato. Catherine, la cadette de Gracianne, née en 1854, s'éteint à l'âge de 20 ans le 22 août. Le 20 septembre, c'est au tour de Dominica dite Domena, âgée de 17 ans (née en 1857) et trois jours après, le 23 septembre, Marie âgée de 15 ans (née en 1859) les suit au cimetière !
A quoi les trois sœurs ont-elles succombé ? Tuberculose, choléra ? (mais au vu des registres, il n'y a pas eu d'autres décès dans la commune cette même année laissant penser à une épidémie). Pire, un autre nom interpelle dans le récapitulatif des décès de 1874 à Béhorléguy, celui de Dominica Larralde, leur mère ! Veuve, âgée de 50 ans, on peut imaginer que Dominica meurt de chagrin le 19 novembre de cette même année. Quelle hécatombe !
Ainsi, lorsque Gracianne alors âgée de 23 ans se fiance avec Jacques Harguindeguy et fait procéder à l'inventaire de la maison, elle se retrouve chef d'une famille décimée. Son oncle maternel Martin Larralde devient tuteur des trois petites sœurs restantes (une est morte en bas âge), Marie-Gasté, Brigitte et une autre Gracianne, âgée de 13, 11 et 8 ans au décès de leur mère. Jean Chembero, cousin de leur père (et de mon aïeule Isabelle) est désigné comme subrogé tuteur.
Il arrive parfois que la généalogie réveille de petits et grands drames intimes enfouis sous de vieux papiers ...
Illustration : Un jour gris dans la vallée, Angel Cabanas Oteiza;
Sources : AD 64 (état civil et archives notariales), Institut culturel basque (Eke-icb) pour les registes de Guillaume Apheça.