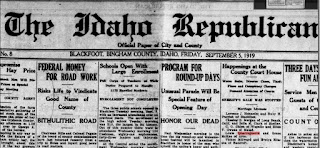En cette Journée Internationale de la Famille*, j'ai choisi dans ma généalogie celle qui me semblait le mieux incarner cette mosaïque de caractères et de destins qui constitue une famille. Sociologiquement parlant, le fait qu'elle ait été issue d'une province "reculée" du Pays basque dans un 19e siècle encore largement rural, et soumise à des traditions très ancrées (primogéniture, rôle de la maison, sort des cadets...), la rendait encore plus intéressante.
Pour cette fois, je ne m'attacherai ni au père, Dominique Irigoyen (1829-1898), instituteur, dont j'ai souvent parlé
ici, ni à la mère, Marie-Jeanne Dargain-Laxalt (1833-1907), propriétaire, elle aussi déjà plusieurs fois
mise à l'honneur, mais à la fratrie issue de ce couple. Mariés le 27 novembre 1851 à Aussurucq (Basses Pyrénées), ils auront quatorze enfants entre 1853 et 1877 dont dix parviendront à l'âge adulte.
L'aînée, Marie dite "Maddie", aurait pu être l'héritière. Née le 17 février 1853 dans la maison Laxalt (ou Laxaltia), elle va pourtant choisir une autre voie ou plutôt répondre à une voix, celle du Seigneur. Entrée dans la Congrégation des Filles de la Croix à Bidache en novembre 1869, elle prend le nom en religion de Sœur Marie Nicéphore. Elle a à peine prononcé ses vœux, le 25 septembre 1871, qu'elle meurt brusquement le 23 novembre suivant, à seulement dix-huit ans.
Curieusement, Marguerite dite Mallaïta, la suivante, née le 31 août 1854, ne se mariera pas dans son village natal mais à Saint-Just-Ibarre (Donisti Ibarre), petit village de Basse-Navarre. Couturière, elle épouse un "manech", Bernard Arruyé (ou Arruyer), brigadier-cantonnier de son état, le 12 juillet 1885. Ils n'auront pas d'enfants, et Mallaïta s'éteindra le 26 mars 1938 dans sa maison Antondeguia à l'âge de 83 ans.
Le premier garçon de la fratrie, né le 9 septembre 1855 se prénomme Pierre. Je ne sais pas grand-chose à son sujet si ce n'est qu'il est gendarme à Lasseube, un gros bourg béarnais de 2200 habitants. A-t-il été blessé, est-il tombé malade ? Toujours est-il qu'il meurt à trente ans, le 5 octobre 1885, dans la maison familiale "Etcheberria". Son nom figure sur le caveau de famille à Aussurucq.
Joseph, né le 16 mars 1857 à Laxaltia comme ses aînés, ne s'éloignera pas beaucoup de la famille. Le 13 novembre 1883, il épouse à Aussurucq une fille du village, Marie Carricart-Garat mais c'est dans le village voisin de Suhare qu'ils vont s'installer comme cultivateurs. Marie lui donnera huit enfants, autant de filles que de garçons et aura la douleur de perdre un fils à la guerre, tombé à Craonnelle en septembre 1915. Joseph lui, s'était éteint en 1902 dans sa maison Urruty de Suhare.
Cinquième de la fratrie, mon arrière-grand-mère Elisabeth naît le 12 avril 1858. Avec son mari Dominique Eppherre (1851-1928), originaire de Sunharette dans la Soule, ils vont avoir onze enfants dont mon grand-père Pierre, né en 1901, sera le petit dernier. Eux aussi vont perdre un fils en 14-18, Michel,
mort à Verdun en 1916. Elisabeth et Dominique vont hériter de l'
etxea (maison, dépendances et terres) d'Etcheberria.
Cadette d'Elisabeth de dix-huit mois, Engrâce est la seule qui va suivre les traces de son père et devenir institutrice. Sa vie m'a semblée tellement romanesque que je lui ai consacré plusieurs
billets, ainsi qu'à ses deux fils,
Jean-Baptiste et Dominique, victimes eux aussi de la folie meurtrière de la Grande Guerre. Comme sa sœur aînée Marguerite, Engrâce avait épousé en 1887 un gars de Saint-Just-Ibarre, Martin Brisé. Malade du coeur, elle décède le 17 avril 1916, à 56 ans.
Marianne dite Mañaña est celle dont j'ai eu le plus de mal à retrouver la trace. Née le 21 avril 1861, elle épousera un cultivateur de Musculdy, Félix Etchebest, de la maison Egnaut avec lequel elle aura trois filles. Elle repose depuis 1952 dans le cimetière de Musculdy où j'ai retrouvé récemment le caveau de la famille Etchebest "Enautenia".
Né le 22 mai 1863 dans la maison Laxalt, un deuxième Pierre y décède le 3 septembre 1873. Ces deux dates encadrent la trop courte vie de ce petit garçon mort à dix ans pour des raisons inconnues. Deux ans plus tard presque jour pour jour, naîtra un petit Martin qui ne vivra que six jours. Entre les deux, Jeanne née le 26 août 1864 aura elle, une longue vie.
La "Tante Jeanna" sera en effet d'abord gouvernante du curé-doyen de Tardets avant de s'installer dans la maison-épicerie-café dite "Zubukota" de sa nièce Julienne Eppherre (1891-1953), fille d'Elisabeth et de Dominique Eppherre. Elle rendra son dernier souffle le 22 juillet 1951 à presque 87 ans, entourée de ses nombreux neveux et nièces.
Les deux suivants, respectivement "numéros" 11 et 12 de la fratrie, Grégoire et Michel, font partie de ces très nombreux cadets partis tenter leur chance en Amérique, ce qui dans leur cas, leur a plutôt réussi. J'ai évoqué l'histoire de "Gregorio et Miguel Irigoyen-Dargain" dans deux précédents billets intitulés
"Deux frères partis faire fortune au Chili".
L'avant-dernier, Jean, naît le 23 septembre 1871 à Laxaltia et décède moins de trois ans après, le 25 août 1874, à Etcheberria (la "maison neuve"). C'est donc dans ce laps de temps que mon aïeul Dominique Irigoyen fit l'acquisition-restauration de son
etxondoa**. Peut-être est-ce ce pauvre petit qui, si l'on en croit la tradition orale, fit une chute dans l'escalier de la nouvelle maison et perdit ainsi la vie ?
Du quatorzième et dernier enfant, Jean-Pierre, né le 22 octobre 1877 alors que ses parents sont déjà âgés respectivement de 48 et 44 ans et que ses aînés ont plus de vingt ans, on ne sait rien ou presque. Lors du recensement de 1901, jeune homme, il vit encore au foyer de sa sœur Elisabeth et son mari Dominique. Sa trace se perd ensuite mais d'après la mémoire familiale, il aurait émigré en Argentine. Paradoxalement, celui qui nous est le plus contemporain est celui pour lequel nous disposons du moins d'informations. Peut-être un jour... ?
*Depuis 1993, les Nations unies ont choisi le 15 mai pour marquer la Journée Internationale des Familles. L'occasion de mieux connaître les questions relatives à la famille ainsi que les processus sociaux, économiques et démographiques qui affectent les familles. Sophie Boudarel, généalogiste professionnelle, propose comme Généathème du mois de mai de nous pencher sur une famille de notre généalogie : En connaît-on tous les membres ? Quels ont été leurs parcours ? Sont-ils tous restés au même endroit ? Ont-ils eu la même destinée ?
**Etxondoa : maison-souche
Illustration : Mauricio Flores Kaperotxipi (1901-1997)
Sources : AD 64 (état civil, actes notariés, fiches matricules, registres d'instituteurs), Gen&O, FamilySearch et mémoire familiale (merci à mon père, mes "tantes" Marie, Thérèse et Georgette, mes cousines Annie et Julienne ainsi que María Isabel et Miguel Hernan au Chili).
Remerciements à Sœur Clotilde Arrambide de la Congrégation des Filles de la Croix à La Puye (86) pour ses précieuses informations sur Sœur Marie Nicéphore.